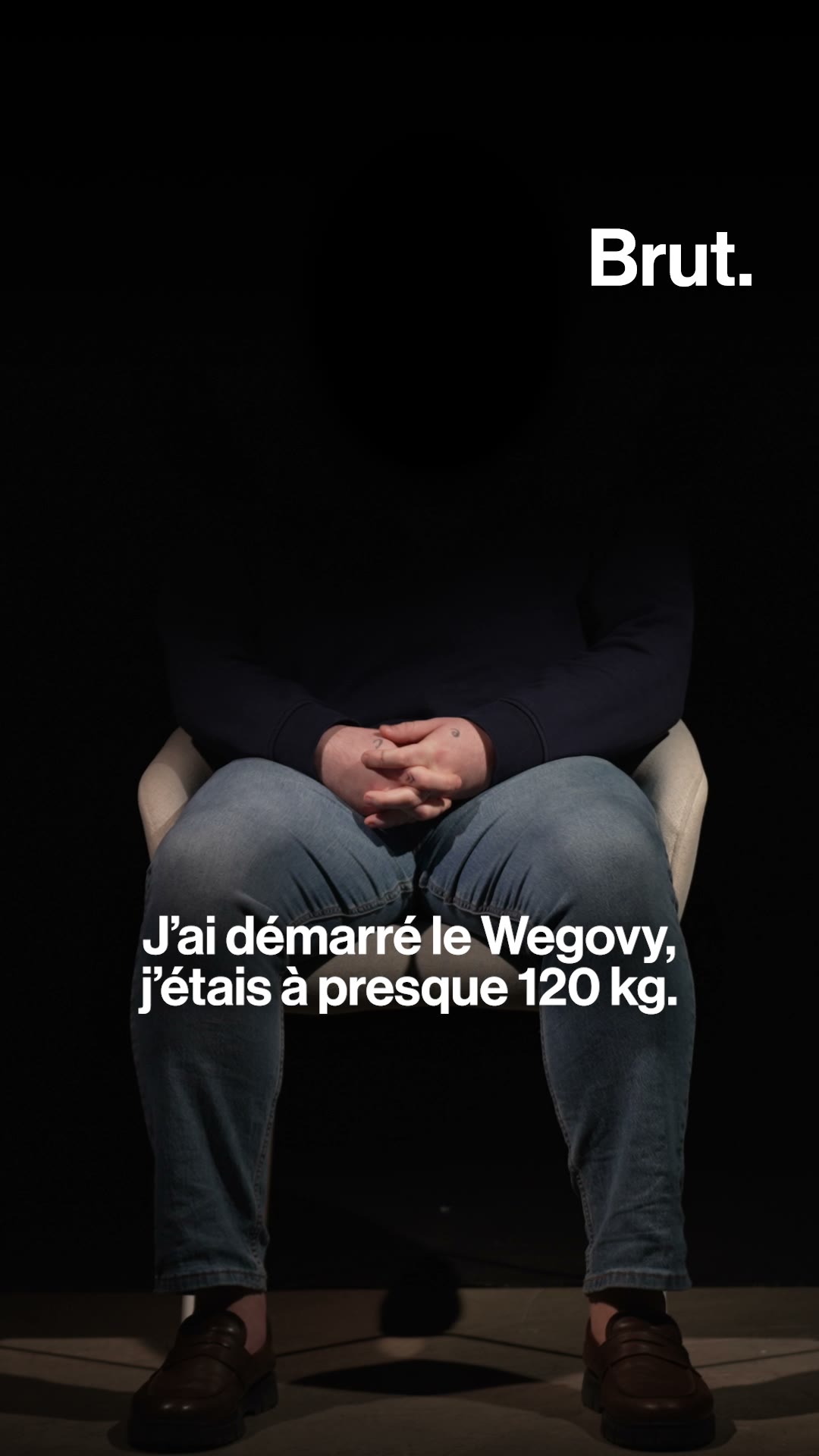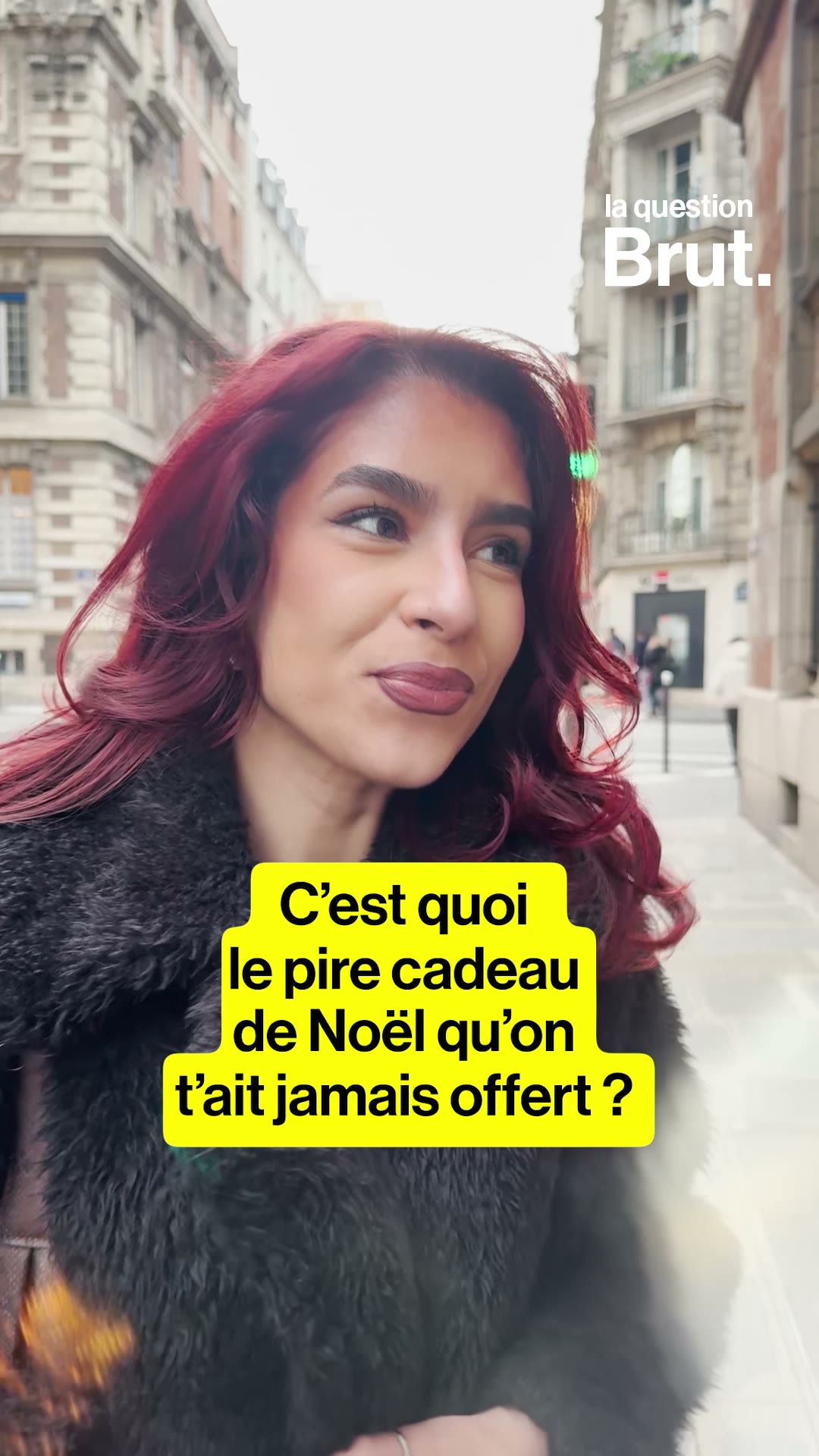Les néonicotinoïdes, ça sert à quoi ?
Disponibles depuis le milieu des années 1990, ces produits neurotoxiques (acétamipride, clothianidine, imidaclopride, thiaclopride, thiaméthoxame, nitenpyrame et dinotéfurane) sont couramment utilisés dans le monde.
Betteraves, blé, colza, arbres fruitiers, vigne... Ils servent à débarrasser les cultures des chenilles, cochenilles, pucerons ou insectes mangeurs de bois, et protéger ainsi les rendements agricoles.
S'ils peuvent être employés en pulvérisation, les néonicotinoïdes sont souvent utilisés de manière préventive, en enrobant les semences qui seront mises en terre, en général en mars. Les utilisateurs mettent en avant que cet usage localisé permet d'éviter d'épandre des insecticides dans les champs à un stade plus avancé du développement des cultures.
Les insecticides tueurs d'abeilles réautorisés, un danger pour la biodiversité
Quels effets sur l'environnement ?
Comme tout insecticide, à certaines doses, les néonicotinoïdes peuvent tuer des insectes autres que ceux ciblés.
Mais la létalité de ces substances peut aussi être indirecte. En butinant les plantes, les pollinisateurs ingèrent certaines quantités de ces insecticides. Et ces derniers, même à faible dose, peuvent s'attaquer au système nerveux de ces insectes, causant chez eux des difficultés à s'orienter, réduisant leur longévité ou leur résistance aux maladies ou des altérations dans la reproduction. Chez les bourdons, des études ont aussi montré des croissances plus lentes ou une production amoindrie de la ruche menaçant sa survie.
D'autres espèces peuvent aussi être affectés, comme les oiseaux en se nourrissant d'insectes contaminés. Des traces de ces substances ont également été retrouvées dans la rate de certains cervidés, affectant leur poids, leurs organes génitaux ou la survie de leurs faons.
Enfin du fait de leur persistance pendant des mois voire des années, les néonicotinoïdes — dont seule une petite partie est absorbée par les plantes, le reste se déversant par ruissellement — s'accumulent et polluent les sols, les eaux de surface et la végétation, affectant les invertébrés et micro-organismes de ces écosystèmes.
Et sur la santé humaine ?
"Des incertitudes majeures" demeurent sur les effets neurodéveloppementaux de l'acétamipride résumait notamment en 2024 l'agence sanitaire européenne, l'Efsa.
Il faudrait de "nouveaux éléments" pour pouvoir en "évaluer de manière adéquate les risques et les dangers", insistait l'agence, appelant pour l'heure à abaisser nettement les seuils auxquels ce pesticide est jugé potentiellement dangereux.
Des études appuient l'idée que les néonicotinoïdes présentent des risques potentiels, mais ne permettent pas de conclure définitivement qu'ils jouent réellement un rôle dans des pathologies chez l'humain, du moins au niveau auquel ces produits sont utilisés dans la vie réelle.
Quelle réglementation de ces substances ?
Les néonicotinoïdes ont, au vu de leurs effets multiples sur l'environnement, fini par susciter l'inquiétude.
L'Union européenne avait en 2013 suspendu l'utilisation de ces substances sur plusieurs cultures, puis a décidé en 2018 l'interdiction totale en extérieur de trois d'entre eux: imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame. Le thiaclopride a été interdit en 2020. L'acétamipride reste autorisé jusqu'en 2033.
En France, une loi entrée en vigueur en 2018 interdit toutes les substances de la famille des néonicotinoïdes. Des dérogations pour certaines cultures, comme la betterave, avaient été accordées pour des semences enrobées uniquement(en 2021 et 2022), mais une décision de la cour de justice européenne a définitivement interdit ces usages en 2023.
Comme la France avait banni les autres usages, elle n'a plus à l'heure actuelle aucun néonicotinoïde autorisé - alors que ses voisins européens peuvent - ou pas - pulvériser de l'acétamipride.
Le retour des insecticides tueurs d'abeilles ?