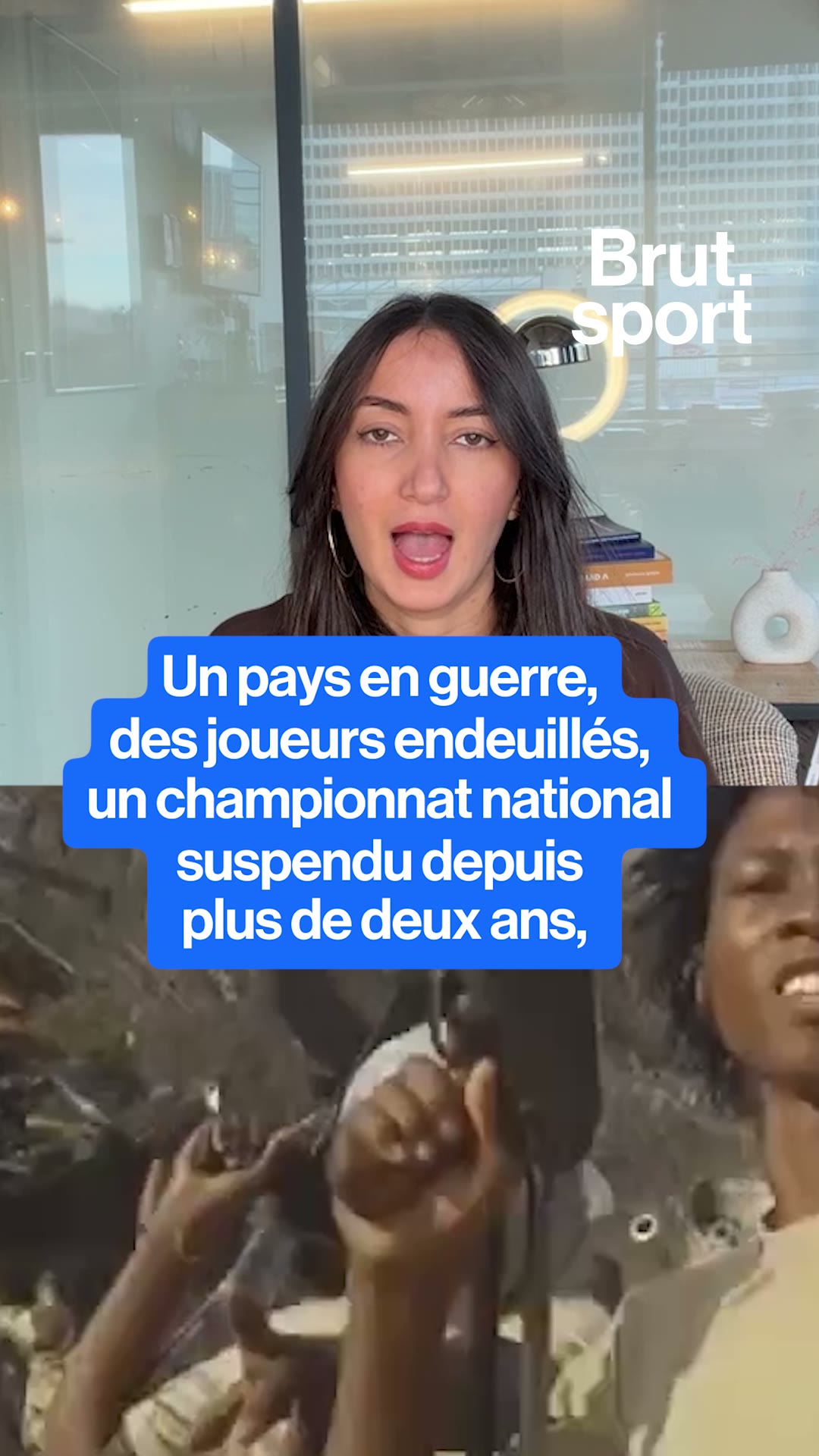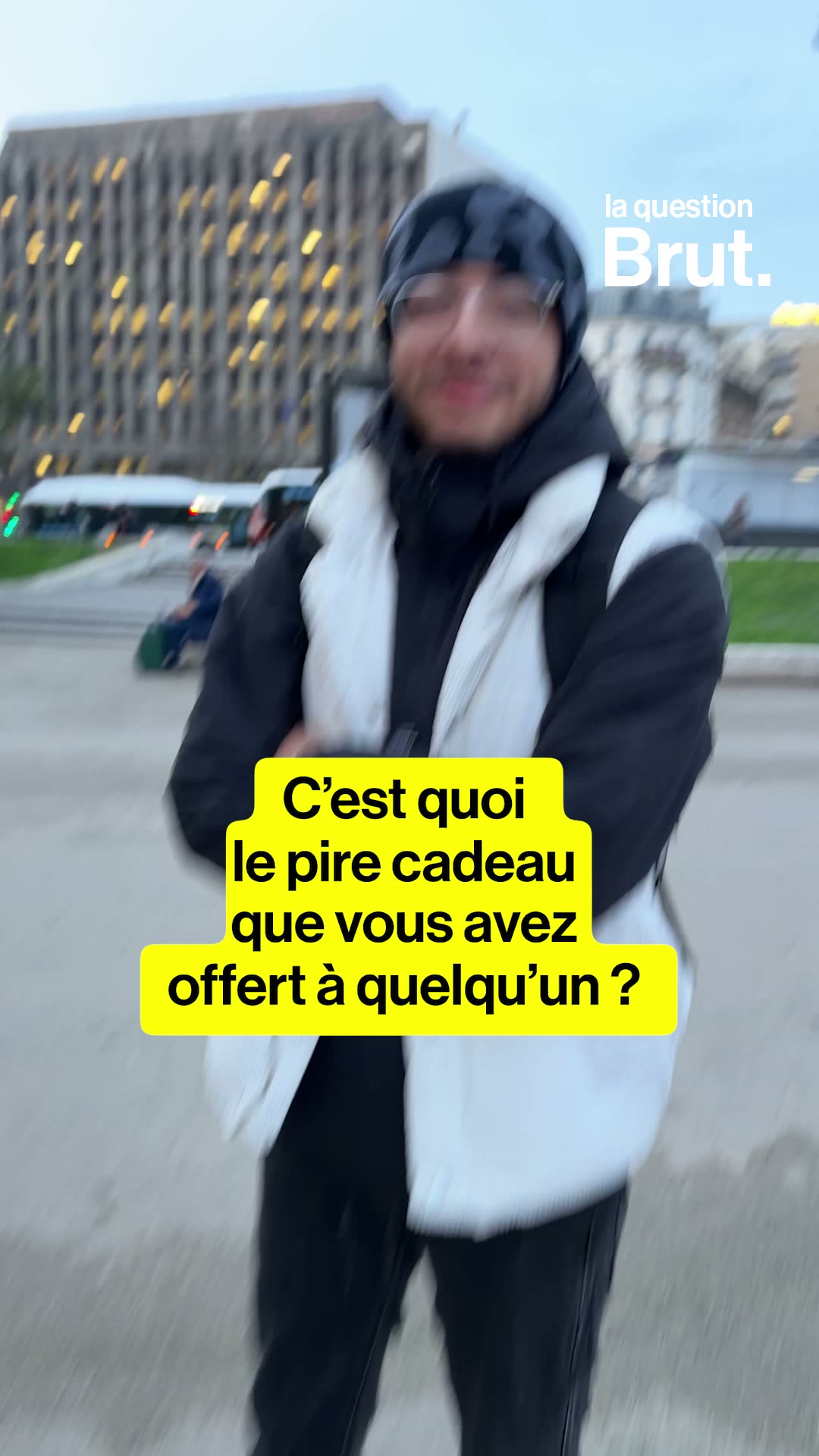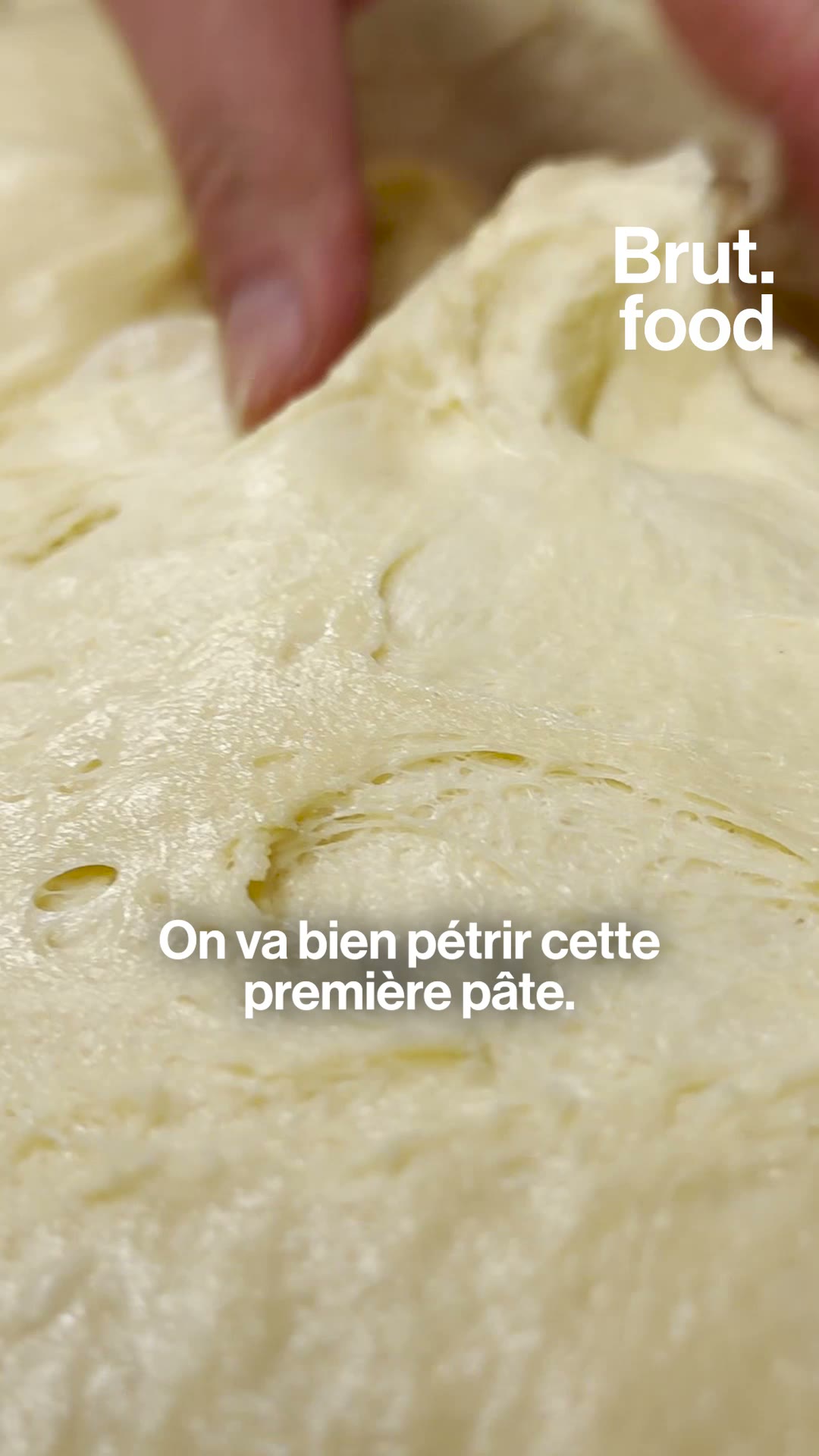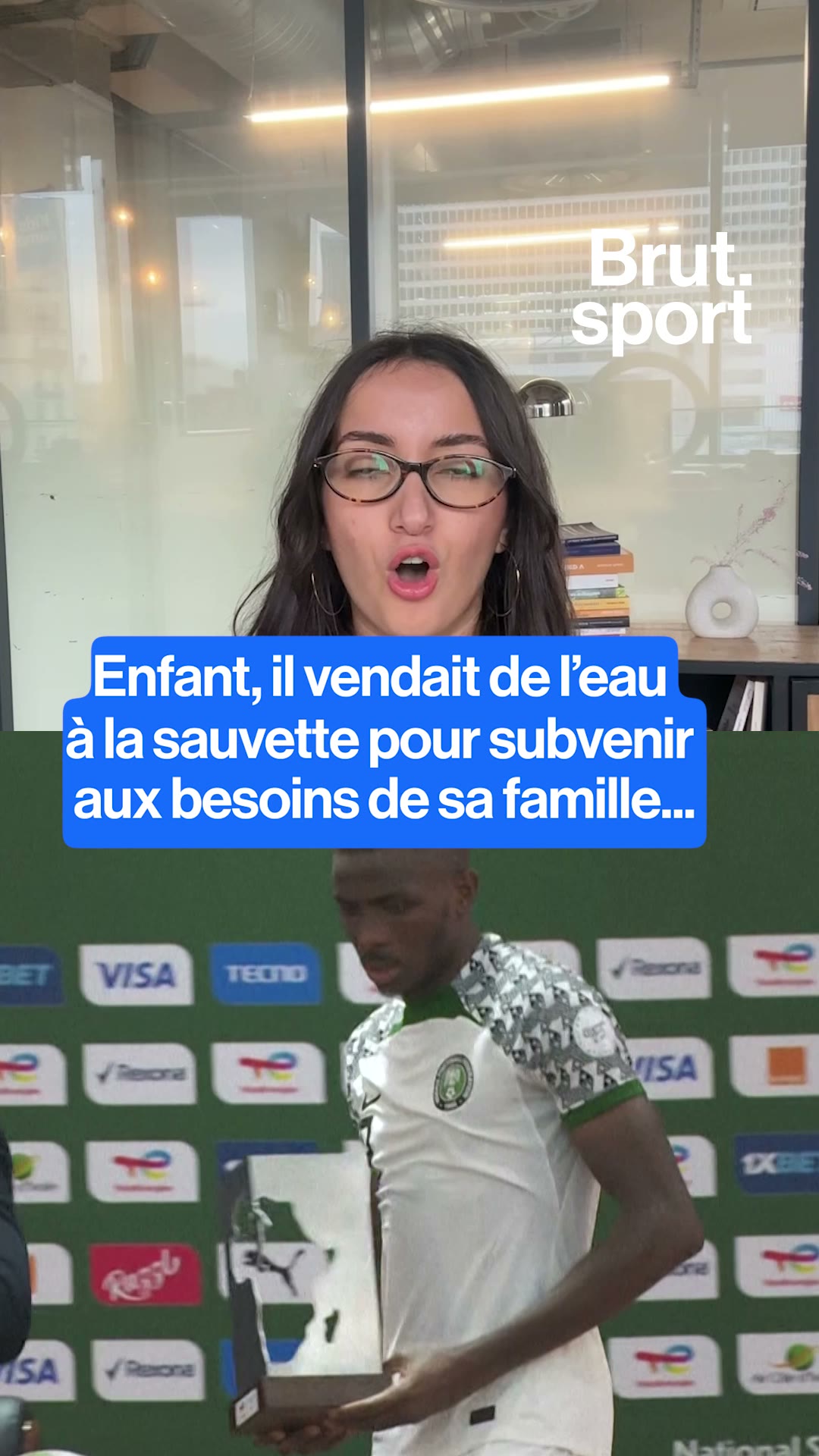Le texte du sénateur socialiste Hussein Bourgi, adopté à l'unanimité même si la gauche l'a jugé "insatisfaisant", entend faire reconnaître à la France sa politique de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles entre 1942 et 1982, date de la dépénalisation définitive de l'homosexualité.
Deux articles du code pénal de l'époque sont visés : le premier fixait un âge spécifique de consentement pour les relations homosexuelles et l'autre aggravait la répression de l'outrage public à la pudeur lorsqu'il était commis par deux personnes de même sexe.
Environ 10.000 condamnations ont été prononcées en vertu de l'article qui établissait un âge de consentement spécifique, et environ 40.000 pour le motif d'outrage public à la pudeur homosexuel, selon Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
"L'homophobie n'a pas simplement été tolérée, elle a été légitimée, institutionnalisée, orchestrée. L'Etat n'a pas seulement laissé faire, il a condamné et il a persécuté (...) Assumer cette responsabilité, c'est refuser l'oubli", a salué la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, favorable au texte.
Condamnations pour homosexualité: bientôt une réparation symbolique ou financière ?
Une compensation financière
En complément de cette reconnaissance de la Nation, la gauche au Sénat a échoué à voir réintroduit un mécanisme de réparation financière au profit des personnes indûment condamnées, soit une allocation de 10.000 euros, assortis de 150 euros par jour de privation de liberté.
Cette mesure qui figurait dans le texte initial représente le principal désaccord entre les deux chambres du Parlement : elle a été approuvée par l'Assemblée nationale mais elle ne convainc pas les groupes de droite et du centre, majoritaires au Sénat, qui la considèrent imparfaite juridiquement et craignent des contentieux.
"Il n'y a pas de précédent en France", a noté le sénateur Les Républicains Francis Szpiner. "La République doit s'excuser d'une situation indiscutablement discriminante", "mais aller au-delà m'apparaît déraisonnable", a-t-il ajouté.
La gauche a regretté cette position. "Nous n'avons pas le droit de minauder, nous n'avons pas le droit de mégoter quand il s'agit de la dignité des personnes", a lancé Hussein Bourgi. "Si vous reconnaissez un préjudice mais que vous refusez de le réparer, alors vous ne l'avez pas totalement reconnu", a repris l'écologiste Mélanie Vogel.
Le gouvernement s'est montré du même avis que la droite sénatoriale, Mme Bergé assurant que "la réparation financière ne peut pas valablement découler de l'application directe d'une loi pénale", tout en évoquant des difficultés liées à la prescription.
Autre divergence entre Sénat et gouvernement d'une part, et députés d'autre part: la période couverte par cette loi mémorielle. L'Assemblée souhaitait la faire démarrer dès 1942, le Sénat a opté pour 1945, estimant que la République n'avait pas à "s'excuser pour les crimes du régime de Vichy".
Le désaccord persistant entre sénateurs et députés obligera l'Assemblée nationale à s'emparer à nouveau de la proposition de loi en deuxième lecture avant toute entrée en vigueur de ce texte soutenu par les associations de défense des personnes LGBT+.
En Hongrie, adoption d'une loi pour interdire la Marche des fiertés