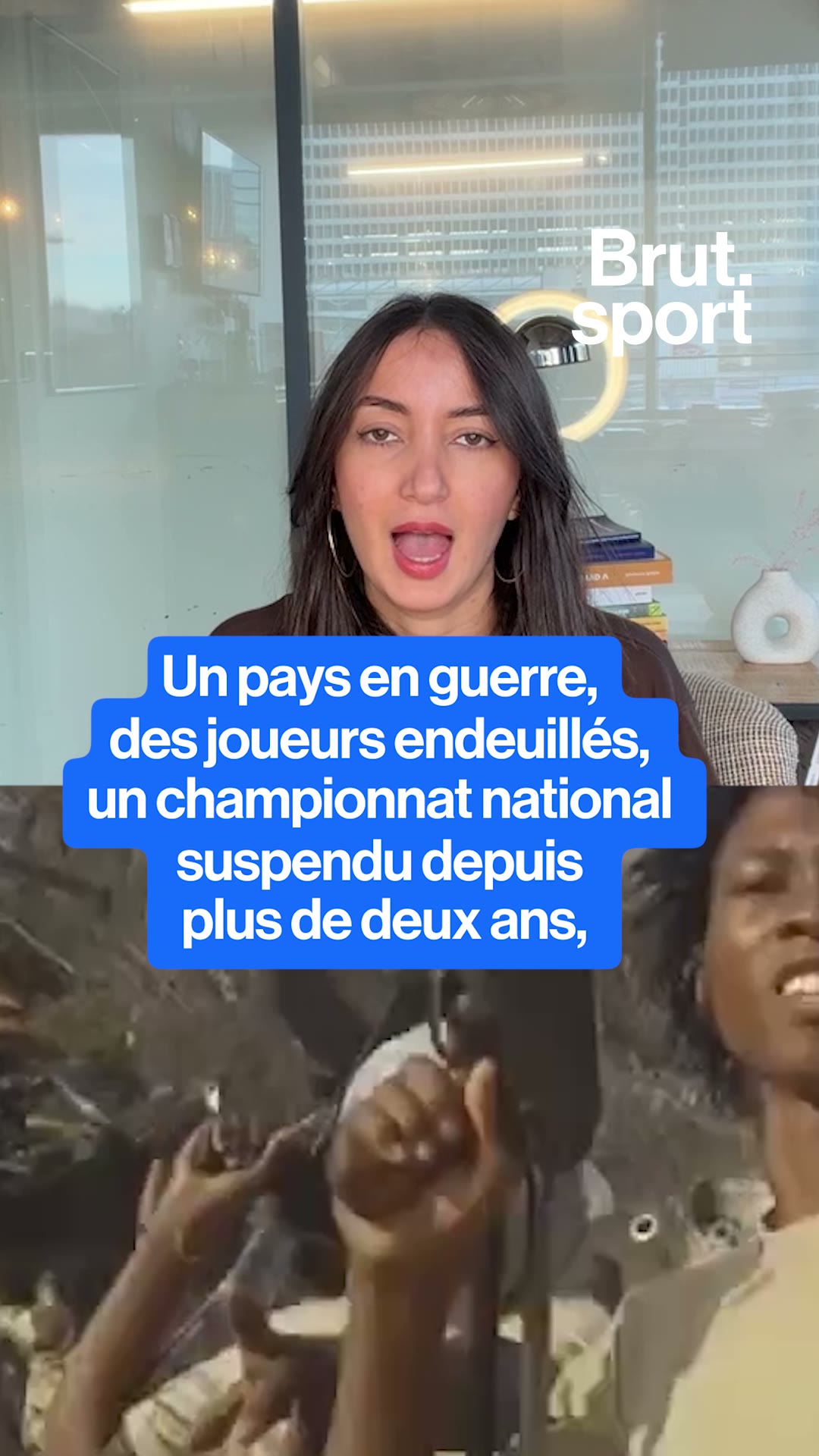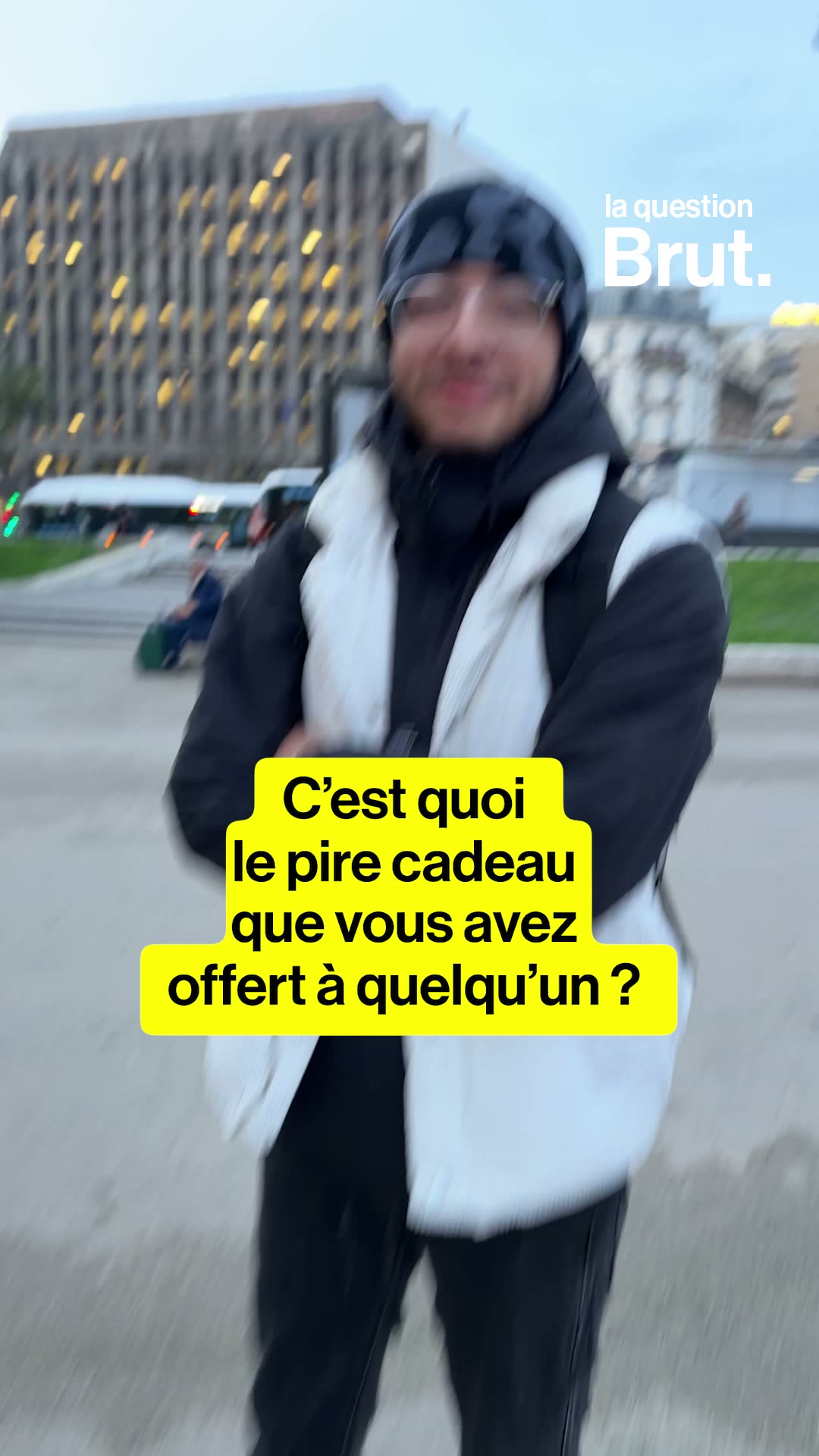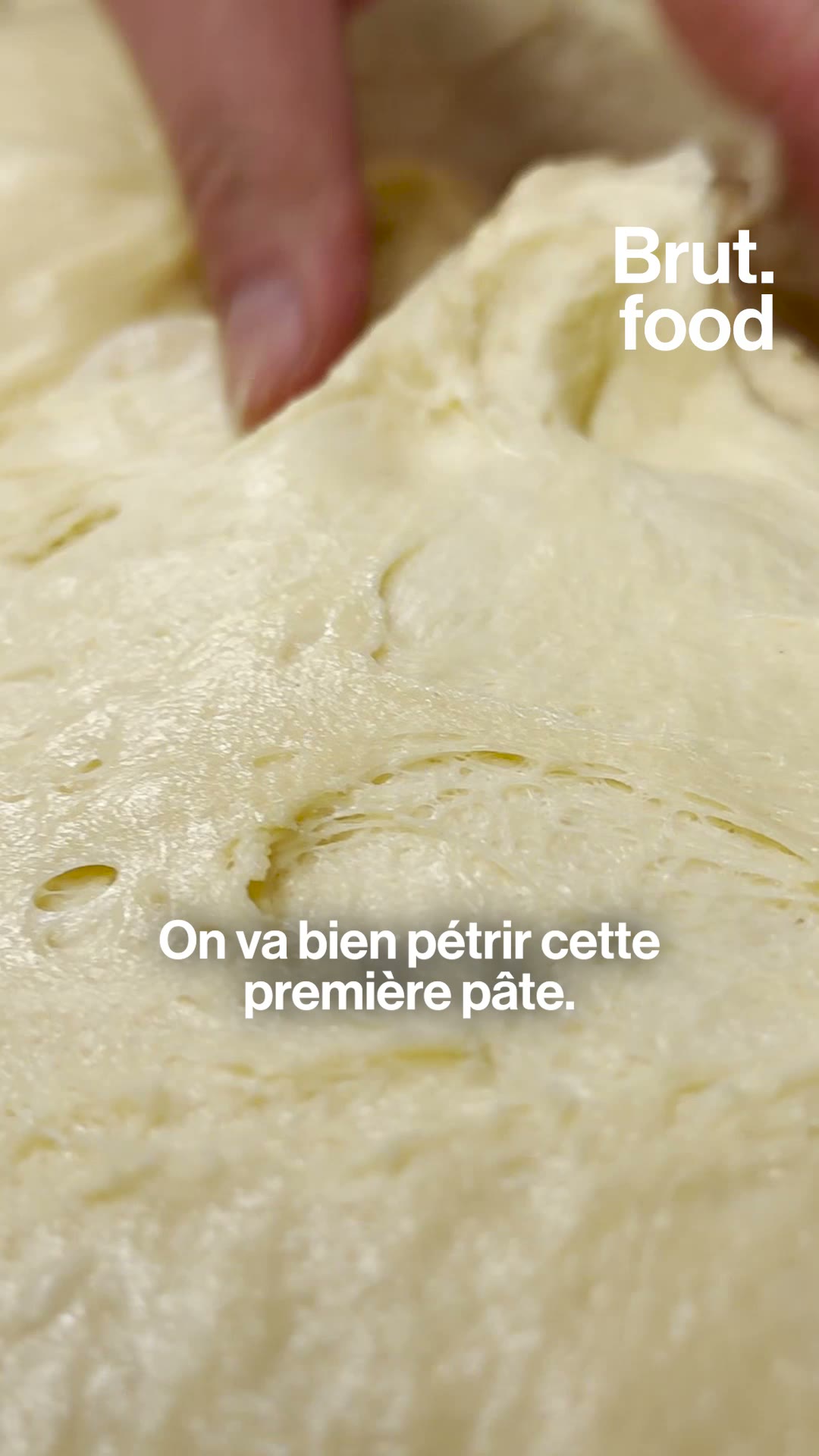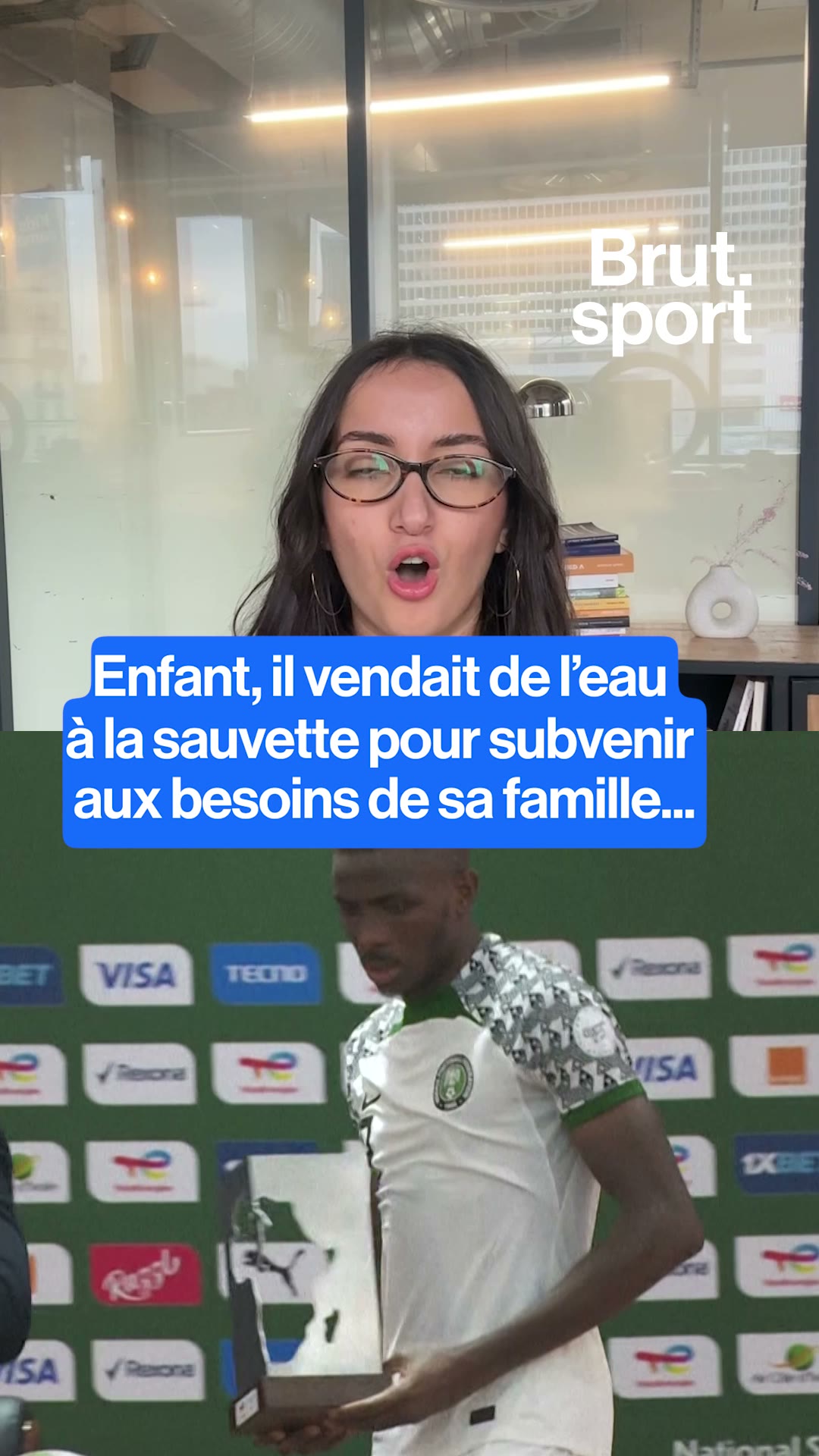Dans l'impossibilité de défendre un projet de budget sous ce régime, il a toutefois la capacité de faire voter des mesures financières d'urgence.
François Bayrou a engagé un vote de confiance contre lequel s'est prononcée une large majorité de députés et a, de ce fait, remis mardi midi au président de la République la démission du gouvernement, conformément à l'article 50 de la Constitution.
C'est la première fois qu'un gouvernement de la Ve République tombe sur un vote de confiance.
Quand le gouvernement chute, il entraîne aussi le gel des textes alors débattus en séance au Parlement puisque le gouvernement ne peut plus venir les défendre devant les députés et sénateurs.
Mais le gouvernement "reste en place, tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau gouvernement, pour assurer au nom de la continuité le fonctionnement minimal de l'Etat", explique une note du secrétariat général du gouvernement (SGG) datée du 2 juillet 2024.
Le gouvernement de Gabriel Attal était resté près de huit semaines démissionnaire, du 16 juillet 2024, quand le président a accepté sa démission remise au lendemain des législatives anticipées, jusqu'au 5 septembre, jour de la nomination de son successeur Michel Barnier.
Les JO en affaires courantes
Cette période d'affaires courantes comprenait la durée des Jeux olympiques de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août.
Michel Barnier est resté moins longtemps démissionnaire, une grosse semaine, puisqu'il a été censuré le 4 décembre, et François Bayrou nommé le 13.
Cette fois-ci, l'Elysée a fait savoir dès lundi que le président Emmanuel Macron souhaitait désigner dans les "tout prochains jours" un successeur au Premier ministre centriste.
Plus les périodes d'affaires courantes sont longues, plus cette notion est "appréciée de façon extensive", relève le SGG.
Les affaires courantes recouvrent d'un côté les "affaires ordinaires" qui participent à "la marche normale de l'Etat" et ne nécessitent "aucune appréciation de nature politique", et de l'autre les "affaires urgentes", dont l'adoption est dictée par "une impérieuse nécessité" (état d'urgence, catastrophe naturelle, trouble à l’ordre public, techniques de renseignement par exemple).
Pour ce qui est des projets de loi, aucun gouvernement en affaires courantes n'en a présenté sous la Ve République parce que, d'une part, toute mesure législative est tenue "pour importante et politiquement sensible" et d'autre part, "il peut sembler inadéquat de saisir le Parlement alors même qu'il est privé de sa prérogative la plus forte, à savoir la possibilité de renverser le gouvernement", explique le SGG.
Rien n'interdit au président de réunir un Conseil des ministres, mais souvent avec un ordre du jour "particulièrement léger", précise le SGG.
Il peut continuer à procéder à des nominations sauf "les plus politiquement sensibles".
Les mesures règlementaires ne sont prises à l'inverse que "par exception", au nom de la continuité de l'État, ou quand elles relèvent de l'urgence.